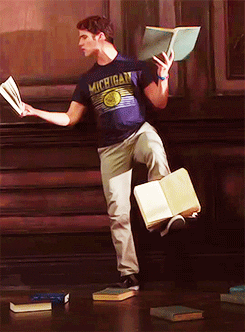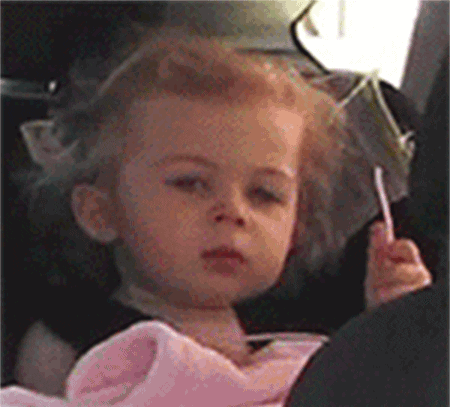Bonjours à tous.tes
Dans quelques jours maintenant, les terminales, moi comprise, passeront le bac de philo. En révisant, je me suis rendu compte avec horreur que je n’avais étudié aucun texte de femme cette année. Zero.
Et lorsque j’ai jetté un coup d’œil dans mon manuel, je me suis rendu compte que, parmi 50 auteurs cités, il n’y a qu’une seule femme…
Et comme je suis persuadée qu’il y’a des philosophes femmes qui méritent d’être connues et utilisées dans les copies, je me suis dit que j’allais en compiler quelques unes ici, en expliquant brièvement leur pensée, afin que vous puissiez les citer au bac, ou dans la vie 😉
Emilie du Châtelet

Principalement (malheureusement) connue pour être la maîtresse de Voltaire, Émilie du Châtelet était avant tout une brillante physicienne et philosophe qui a travaillé sur la morale et a notamment inspiré Kant. Mais je voulais davantage me concentrer sur son ouvrage Discours sur le Bonheur, inspiré d’Epicure, qui donne sa vision personnelle, et non censurée (le livre n’étant pas destiné à la publication) sur le sujet. Pour elle, il y a trois conditions pour atteindre le bonheur, qui doit être le but de la vie. Tout d’abord, le dépassement des préjugés, surtout ceux religieux. Ces préjugés nous conduisent au vice et
« On ne peut pas être heureux et vicieux ».
En effet, l’homme est un être social et il est essentiel qu’il fasse preuve de vertu et participe au bonheur de la société. Si il est immoral, il s’attirera le mépris de ces semblables et donc, le malheur. Elle explique également que l’homme doit se laisser aller aux illusions de l’art, qui nous donnent des sentiments agréables, comme le rire au théâtre. Finalement, l’homme est un être de sensations et de passions : il est nécessaire de les accepter
« nous n’avons rien à faire dans ce monde qu’à nous procurer des sensations agréables »
C’est une fois que l’homme aura compris qu’il doit rechercher l’agréable qu’il sera vraiment heureux.
A citer en parlant
> du bonheur, du devoir, de l’art
Rosa Luxemburg

Née en 1871 en actuelle Pologne, alors annexée par l’Empire Russe, Rosa Luxemburg participe à l’avènement d’une pensée socialiste. Ce que je trouve intéressant dans son parcours, c’est qu’elle n’a jamais cessé de remettre en cause le courant socialiste, souvent en désaccord avec ses camarades de lutte. Par exemple, si elle a toujours cherché à renverser le système tsariste et la bourgeoisie, elle critique le gouvernement mis en place par Lénine. Dans La Révolution Russe (1918), elle écrit
« La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement »
Selon elle, le pouvoir autocratique de Lénine empêche la dictature du prolétariat. En effet, la classe ouvrière ne peut dominer que si elle est éduquée politiquement, si elle a pu s’exprimer, se faire un avis et participer à la vie politique. Or, cette liberté a été supprimée par les bolcheviks au pouvoir.
On pourrait la citer en parlant :
> de la liberté, l’Etat, la justice
Olivia Sabuco

Oliva Sabuco est une médecin et philosophe espagnole du XVIème siècle. Elle est l’une des premières à théoriser que les émotions ont des effets sur le corps humain : c’est la théorie psychosomatique (du grec psyché, l’esprit et soma, le corps). Dans son ouvrage, « nouvelle philosophie de la nature humaine », elle fait discuter trois paysans, afin de montrer que la philosophie ne dépend pas de la condition sociale. Aussi, la figure du paysan est un lien explicite avec la nature. Car selon Olivia Sabuco, le corps, l’âme et le cosmos sont interdépendants. Les maux du corps sont d’abord les mots de l’esprit, et peuvent être soignés grâce à des paroles bienveillantes, la religion ou même la musique. L’âme est donc indissociable du corps, et soigner les maux de l’esprit revient à soigner le corps lui-même.
On pourrait la citer en parlant :
> du langage, de l’inconscient
Ayn Rand

Je suis très hermétique à la philosophie proposée par Ayn Rand. Pourtant, je la trouve vraiment intéressante dans ses extrêmes. Ayn Rand a grandi en URSS. Tout le contraire du modèle politique qu’elle propose : un capitalisme poussé à l’extrême et une influence minimale de l’Etat. Car en effet, l’état providence met en place, selon elle l’exploitation des « hommes accomplis » au profit des « incompétents ». Ayn Rand affirme en effet que la plus grande vertu est l’égoïsme : il ne faut penser qu’à soi et vivre que pour soi, c’est là qu’on atteindra le bonheur… Elle rejette l’altruisme et l’abnégation, en affirmant que :
« L’individu se doit d’exister pour lui même et ne jamais se sacrifier pour les autres »
Sa pensée est encore très influente aux États-Unis, et elle est citée à plusieurs reprises par…Trump. C’est une philosophie très extrême qui est intéressante à remettre en cause en l’opposant avec d’autres philosophes qui pensent la morale et le bonheur comme le service à l’autre et l’abnégation.
On pourrait la citer en parlant de :
> le devoir, la justice, l’état, la liberté
Maria Zambrano

Maria Zambrano est une philosophe espagnole, au cœur des mouvements politiques et intellectuels de l’Espagne des années trente. Elle quitte l’Espagne de Franco pour un exil qui durera quarante-six ans, entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Maria Zambrano a particulièrement écrit sur la relation entre poésie, philosophie et religion, sur le rapport des hommes à leur monde. Elle s’interroge sur la nature humaine à travers ses manifestations, ses réalisations. Dans L’homme et le divin, elle explique que les hommes sont passés dans leur histoire d’une attitude poétique à une attitude philosophique. Au début de son Histoire, l’homme voyait le monde de façon poétique, en divinisant son monde. Mais peu à peu, les hommes constatent l’absence de présence divine. Dès lors, ils problématisent, établissent des concepts. Leur vision du monde devient philosophique, ils se posent des questions alors que la poésie était une réponse.
Je pense que Zambrano est particulièrement dure à placer mais son œuvre m’a beaucoup intéressé et j’ai voulu en parler dans cet article !
On pourrait la citer en parlant de :
> la religion, l’art, la nature, le langage
Philippa Foot

On arrive à la dernière (et peut être ma préférée) philosophe de cet article !
Philippa Foot a fait ses études à Oxford au milieu du XXème siècle et est considérée comme une fondatrice de l’éthique de la vertue contemporaine. Elle est principalement célèbre pour avoir inventé le dilemme du tramway : imaginons un train lancé à grande vitesse qui va écraser une dizaine de personnes, peut-on jeter un homme sur le train afin de l’arrêter. A travers ce dilemme, elle illustre le problèmes de l’avortement qui se posait à l’époque, lorsque la vie de la mère était en danger. Est-il moral de tuer le fœtus pour sauver la vie de la mère ? A travers le dilemme du tramway s’expriment les trois grandes écoles d’éthique.
- L’éthique des conséquences inspiré par l’utilitarisme de Bentham (une action est morale si elle argumente le bien être être et réduit le malheur)
- l’éthique des devoirs de Kant (une action est morale si elle n’utilise personne comme moyen)
- l’éthique des vertus d’Aristote (une action est morale lorsqu’elle est réalisée par une personne juste qui contribue à la réussite de la vie des autres).
Grâce au dilemme du tramway, on voit que des philosophes d’hier (Kant, Aristote ou Bentham) peuvent encore être pertinents dans des dilemmes contemporain (l’avortement à l’époque de Foot).
On peut la citer en parlant
> de la justice, du devoir
Voilà, j’espère que je vous aurai fait découvrir des philosophes et que vous les re-utiliserez (n’hésitez pas à m’en informer). Je me lance le défi d’écrire deux noms de femmes dans ma copie ! Bon courage pour les épreuves, les vacances arrivent !
Garance